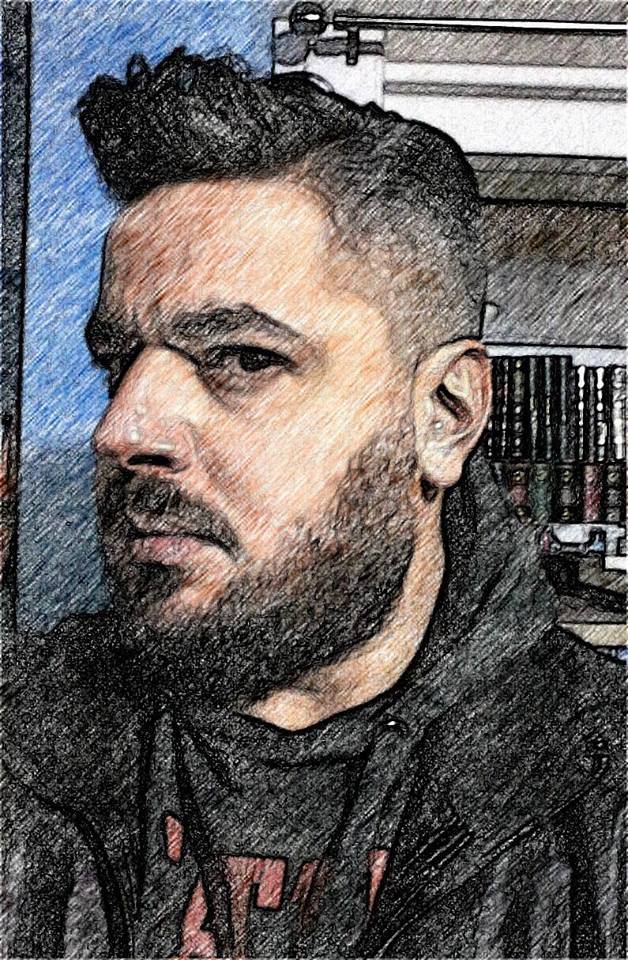Certes, ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus, écrivait Bernanos.
C’est lui qui vient
Quand j’étais plus jeune, j’étais enfant de chœur et j’assistais souvent le prêtre pour les funérailles. Quand j’y repense, j’ai encore en tête cet étrange chant liturgique qui résonne encore à mes oreilles avec sa cadence langoureuse et sensuelle, à la saveur moyen-orientale. Je ne l’ai plus jamais entendu depuis cette époque où il accompagnait l’entrée du cercueil dans l’église, il disait: « Elohi, elhoi, lama sabachtani… C’est lui, c’est lui qui vient, dans la Pâques du Seigneur, Elohi, Elohi… ». J’en restais toujours troublé jusqu’aux larmes : ce chant rendait la mort plus somptueuse et plus douce.
A cette époque, j’ai vu mourir beaucoup de monde et j’ai assisté à bien des agonies imprévues. Cependant toutes les agonies lucides auxquelles j’ai assisté présentaient une constante immuable, quelque chose qui les unissait, comme bien peu d’autres moments dans une vie.
Je repense à toi, la petite vieille des jours heureux quand tu suffoquais avec tes poumons malades. Je vois tes yeux marrons qui devenaient vert et transparents un instant à peine avant d’être voilés par la mort qui vient.
Tu fixais obstinément quelque chose sur la porte, puis tu as réussis à faire un geste : déplacez-vous ! Cherchais-tu la lumière ? Avais-tu besoin d’air ? Attendais-tu quelqu’un qui devait arriver par-là ? Y avait-il déjà quelqu’un ?
Alors nous nous sommes déplacés et tu as retrouvé le calme dans la mort.
Je repense à toi, homme des douleurs, toi qui avais déjà parcouru 30 longues années d’un interminable chemin de croix, quittant cette vie peu à peu. Tu étais allongé dans la pénombre de ta chambre, les toxines hépatiques s’étaient réveillées de leur long sommeil : elles te gonflaient, te jaunissent et te tuaient. Et tout à coup, tu as demandé « mais est-ce que par hasard je ne serais pas en train de mourir ? ». Une question qui pouvait blesser à mort les personnes qui t’aimaient parce que ça tue de devoir mentir par amour. Mais ce n’était plus nécessaire.
Ce soir-là et puis le soir suivant et encore celui d’après, dans la pénombre de ta chambre où tu conservais, tel un gage de la miséricorde divine, ces 30 stations immobiles que tu avais parcourues dans ton chemin de croix sur la terre, tu fis signe à ta fille de se déplacer.
« Déplace-toi, il y a Jésus devant la porte, tu ne le vois pas ? »
Elle s’est enfuie morte de peur, peur de ce que cela voulait dire.
Et puis tu as lui dit de se taire : « Chuut, chuut, il y a Jésus en silence, il me regarde, près de la commode. »
On ne t’avais jamais connu religieux extérieurement et pourtant, à l’heure de rendre les comptes, c’est Jésus que tu voyais en premier.
Le dernier soir, tu as dit : « Il est là, il est venu pour moi, il a toujours été là, il vient me chercher. »
Et il t’a pris avec lui.
Mère d’amour
J’écoute ton cœur, vieille branche, monument d’égoïsme aux pieds d’argile, toi qui causa tant de malheur autour de toi. Blanc et jaunâtre sur ton lit de mort, tu as retrouvé la candeur de l’innocence, tu remontes le temps dans un voyage qui te rend ta jeunesse, ton enfance dans les bras de ta mère aujourd’hui que tu serais encore plus âgée qu’elle, père de ta propre mère.
La mère. Combien d’hommes n’ai-je pas vu abandonner cette vie avec pour dernière pensée celle qui fut également leur première pensée quand ils vinrent au monde : la mère. Cet instinct ancestral, primaire, hors du temps, éternel comme la mort et pourtant jamais domestiqué: la mère.
Au milieu de ton délire, tu l’invoquais, mais c’était un moment de lucidité. Tu l’appelais par son nom parce que tu la voyais : elle t’attendais patiemment comme tous les dimanches quand descendait le soir.
« M’man, maman, attend, attend : j’arrive, me voilà m’man ». Ensuite tu restais là, comme si tu écoutais quelque chose, sans doute l’un de ces conseils impérieux et pleins de franchise que donnent les mères. « Oui, oui », répondais-tu. Et tu ouvrais les yeux en t’adressant à tous : « je vous demande pardon si je vous ai fait du mal ! ». Et, obéissant, tu tombais dans le sommeil éternel avec un dernier « M’man » aux lèvres.
Ce lien terrible que même la mort ne peut briser, ce lien du sang entre les garçons et leurs très saintes mères, abri sûr, berceau et tombeau, refuge de nos premiers et de nos derniers jours.
La maternité a quelque chose de surnaturel, elle porte le souffle divin en son sein. Et c’est ce souffle qui est la dernière bouffée d’oxygène que l’homme prendra sur cette terre avant d’expirer.
Mater Dulcissima !
Du berceau au tombeau
 Et enfin toi mon ami, toi qui compris au dernier moment que tu étais en train de mourir, alors que déjà ta lucidité déclinait et que tu sombrais dans le délire de la mort : n’est-il pas curieux qu’il faille un travail pour venir au monde et un autre travail, solitaire cette fois, pour nous en séparer ? Tu es mort en chrétien de cœur, et pourtant…
Et enfin toi mon ami, toi qui compris au dernier moment que tu étais en train de mourir, alors que déjà ta lucidité déclinait et que tu sombrais dans le délire de la mort : n’est-il pas curieux qu’il faille un travail pour venir au monde et un autre travail, solitaire cette fois, pour nous en séparer ? Tu es mort en chrétien de cœur, et pourtant…
Tu invoquais ta mère comme l’on invoque la Dame qui a écrasé la tête du serpent, la Toujours Vierge, la Sans Tâche :
« Maman ».
Et ensuite tu récriminais plein de colère contre l’autre femme, l’Ève qui avait semé la destruction dans le règne de ta mère : « Cette sale chienne ! », disais-tu dans l’agonie.
C’était la vérité.
Et puis tu répétais « Maman » comme ces soirs où tu allais retrouver ta vieille maman, pleine d’ironie alors qu’elle portait toutes les douleurs du monde sur ses épaules, les douleurs des mères : tu passais sa porte et tu criais « Maaamaaan ! ». Et naturellement, elle, sourde comme un pot, ne t’entendais jamais.
C’était pareil ce dernier soir : tu criais en franchissant cette autre porte qui, encore une fois, te rapprochais d’elle.
Tu criais son nom.
Et ensuite tu jurais. Et puis tu pardonnais. Et tu haïssais. Et tu aimais.
Mais ta dernière parole fut un mot d’abandon et de pardon, une parole d’amour : la première et la dernière parole qu’un homme apprend à prononcer : « Ma… man ».
Combien de fois n’avons-nous pas au moins une fois pensé à ce drame intime : « Le jour où ma mère ne sera plus là, personne au monde ne m’aimera d’un amour aussi absolu, totalement inconditionnel et gratuit. J’apprendrai l’art amère de l’amour à durée déterminée obéissant à des lois, limité par des règles. » Nous apprenons à être seuls au monde, orphelins. Et pourtant la mère demeure… jusqu’à la fin.
Comment rendre grâce à Dieu pour un don si délicat, si cruel, pour ce signe de contradiction planté jusqu’au tréfonds de l’âme ? Comment rendre grâce de nous avoir voulu mammifères ? J’ai toujours pensé qu’une mère était un aperçu de l’amour céleste. Un amour absolu.