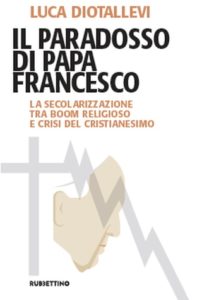 Panama, Émirats arabes unis, Maroc, Bulgarie, Macédoine, Roumanie… Au cours des cinq premiers mois de cette année à peine, le pape François a inscrit à son agenda autant de voyages hors d’Italie qu’il n’en effectuait auparavant en toute une année. Et d’autres suivront encore en Afrique et en Asie. C’est aussi cela qui fait de lui une « star » internationale. L’image de l’Église catholique s’identifie toujours plus avec la personne du pape et de son « succès » planétaire.
Panama, Émirats arabes unis, Maroc, Bulgarie, Macédoine, Roumanie… Au cours des cinq premiers mois de cette année à peine, le pape François a inscrit à son agenda autant de voyages hors d’Italie qu’il n’en effectuait auparavant en toute une année. Et d’autres suivront encore en Afrique et en Asie. C’est aussi cela qui fait de lui une « star » internationale. L’image de l’Église catholique s’identifie toujours plus avec la personne du pape et de son « succès » planétaire.
Dans l’opinion publique, Jorge Mario Bergoglio joui certainement d’une vaste popularité, même si elle a récemment baissé dans un pays-clé tel que les États-Unis. Rien de tel en revanche pour l’Église catholique qui souffre pratiquement partout d’un « insuccès » flagrant.
C’est cette contemporanéité du succès du Pape et de l’insuccès de son Église qui constitue l’un des casse-têtes de la sociologie des religions d’aujourd’hui.
Un casse-tête auquel Luca Diotallevi, professeur de sociologie à l’Université de Rome Trois et ancien senior fellow au Center for the Study of the World Religion de la Harvard Divinity School, qui a également été le politologue de référence de la Conférence épiscopale italienne durant le pontificat précédent, apporte une réponse originale dans son dernier essai qui vient de sortir de presse.
*
Toutefois, avant de tenter d’apporter une réponse à ce casse-tête, Diotallevi commence par en affronter un autre qui s’impose d’emblée. Il consiste à s’interroger sur la validité ou non du paradigme classique de la sécularisation selo lequel « plus la modernité avance, plus la religion est marginalisée voire disparaît, et avec elle le christianisme ».
En effet, cet ancien paradigme fonctionne dans de nombreux cas mais pas dans d’autres, comme justement par exemple dans le cas du pape François.
Tandis qu’au contraire, dans d’autres cas, c’est la théorie de la différenciation sociale élaborée par le sociologue et philosophe allemand Niklas Luhmann (1927–1998) qui semble être un instrument d’analyse très efficace.
Diotallevi consacre plusieurs pages à illustrer le paradigme luhmannien. Il en souligne la pertinence surtout quand il montre comment chaque sous-système par lequel une société se différencie nécessite, pour fonctionner, des « langages » spécialisés, qui pour la politique peuvent être les lois, pour les décisions judiciaires le droit, pour l’économie l’argent… Et pour le christianisme ? Diotallevi remarque – à juste titre – qu’ « il n’est pas surprenant du tout qu’au cours du Concile Vatican II et des années qui ont suivi, c’est la question de la liturgie et de sa réforme qui a été au centre de la controverse au sein du catholicisme. » Tout en gardant à l’esprit que dans une société à un niveau de modernisation élevé, le rite ne constitue pas la seule modalité communicative possible pour une religion qui veut « dire Dieu » aux hommes.
Pour Luhmann également, comme pour le paradigme classique, l’avancée de la sécularisation marque le déclin et la disparition des religions du modèle « confessionnel » qui sont effectivement partout en crise aujourd’hui. Mais les religions et en particulier le catholicismes ne sont pas toujours réductibles à ce seul modèle.
Ce à quoi nous sommes en train d’assister dans le monde entier, c’est en fait un boom religieux qui ne relève pas du « confessionnel » mais plutôt d’une « récupération sélective des traditions à la fois qui est à la fois très moderne et sans le moindre scrupule ». Ce sont « des styles, des symboles et des rhétoriques employées à la carte pour pénétrer des niches de marché spécifiques », avec « une demande religieuse qui prime très nettement sur l’offre religieuse ».
C’est cela la « low intensity religion », la religion à basse intensité – écrit Diotallevi – qui occupe « la grande scène socioreligieuse actuelle ». Même le catholicisme en est largement empreint. Elle fait fi di des interdits et les barrières qui s’opposent à la consommation religieuse individuelle, elle ignore les préceptes doctrinaux et moraux qui prétendent orienter la voie des individus et de la société politique, elle refuse l’arbitraire d’une autorité religieuse supérieure. La participation habituelle aux rites décline tandis que la consommation individuelle de ceux-ci devient toujours plus inorganisable et imprévisible.
Ce que cette mutation entrave – soutient Diotallevi – c’est surtout la forme d’Église voulue par Vatican II et par Paul VI, une Église projetée pour « un régime de société ouverte et de liberté de conscience », une Église capable de combiner « une grande autonomie avec un grand impact extra-religieux ». Ni Jean-Paul II ni Benoît XVI – à son sens – n’ont pu donner une substance adéquate à ce projet, et ensuite c’est la renonciation « révolutionnaire » de Joseph Ratzinger au pontificat qui est venu clôturer la longue parenthèse, qui aura duré des siècles, de l’Église catholique « confessionnelle » et qui a rouvert un espace pour un nouveau rapport du catholicisme avec la modernité avancée.
Et c’est dans cet espace que s’engouffre le pape Bergoglio en 2013. Ce qui nous amène à aujourd’hui.
*
Avant de s’attaquer au casse-tête du succès de François au sein d’une Église en plein insuccès, Diotallevi écrit avant tout que le succès du pape actuel, c’est le succès d’une « religious celebrity » qui n’a rien d’original mais qui est intentionnellement amplifié par l’appareil médiatique qui l’entoure – sans en évaluer l’efficacité ni les coûts – et qui tend dangereusement à alimenter ce processus de « réification et de marchandisation de la religion » qui est caractéristique du boom religieux actuel.
Un second facteur de succès, pour le pape François, c’est – selon Diotallevi – l’atténuation de la rigueur doctrinale dans l’orientation de la pratique religieuse.
Un troisième facteur, c’est la simplicité « franciscaine » qu’il exhibe. Celle-ci consiste en une stratégie faite de « soustraction continue et raisonnée » par rapport aux codes de conduites papaux du passé et qui finit par confondre en lui le rôle de « chef du gouvernement » avec celui de « chef de l’opposition », sans toutefois de véritable projets de réforme alternatifs, nécessairement complexes.
En outre – écrit Diotallevi – il faut tenir compte d’un effet de grande importante et de longue durée du succès du pape François. Il s’agit d’un effet particulièrement visible en Italie mais pas seulement. « François a bouleversé l’identification religieuse catholique ». Alors qu’avant, les catholiques plus ou moins pratiquants avaient « comme référence de leur propre appartenance religieuse non pas le pape, non pas le diocèse, certainement pas les groupes et les mouvements mais bien la paroisse, c’est-à-dire l’institution religieuse de forme ecclésiale la plus répandue, qu’on peut certes ne pas fréquenter mais qu’on ne peut choisir selon son bon vouloir, cela a aujourd’hui sauté avec le pape François ». La référence c’est lui et rien d’autre. Cette personnalisation est un trait constant de la religion « à basse intensité ». S’il ne l’a pas voulue, il est clair que « le pape François ne s’y est pas opposé. »
*
Ensuite, il a la diminution des ressources humaines : moins de prêtres, moins de sœurs, moins de laïcs dans les mouvements et les associations. Ils se réduisent en quantité et en qualité. Et on a de plus en plus tendance « à céder toujours davantage à la demande des consommateurs » et à suivre des paradigmes religieux ou culturels extérieurs au catholicisme.
L’intérêt de l’Église à peser sur la configuration de la société diminue également. Pendant que, par exemple, le profil légal de la famille est en pleine transformation – remarque Diotallevi – « la participation des catholiques au dialogue public selon les formes propres à la dynamique politique fait défaut ou s’affaiblit ». En ce qui concerne les œuvres catholiques, l’engouement est en diminue principalement dans les écoles et dans le monde de l’édition, c’est-à-dire dans les secteurs à plus forte valeur ajoutée au niveau culturel, et certains vont même jusqu’à se réjouir d’un tel désengagement au nom du paupérisme et de la laïcité. En Italie, le « projet culturel » promu par la conférence épiscopale italienne au cours des pontificats précédents a été annulée sans que rien ne vienne le remplacer.
*
Et donc, face à ces deux tendances qui se répandent aujourd’hui l’Église catholique, entre une religion « à basse intensité » et un néo-confessionnalisme résiduel, que fait le pape François ? Ses déclarations et ses actes de gouvernement « élaborent-ils et mettent-ils en œuvre de façon adéquate, à plus de cinquante ans de la fin du Concile, le programme de ce retournement ecclésial » ? A plus forte raison aujourd’hui que « l’Église catholique est affaiblie et que les défis d’une forte modernisation se sont font de plus en plus sentir » ?
A ces deux questions, Diotallevi répond par la négative. Et il l’explique, entre autre, en prenant l’exemple d’ « Amoris laetitia » et son « estompement » de la doctrine sur la famille en faisant mine de ne pas y toucher, avec le résultat de passer « du cas par cas au chaos au régime d’évêque par évêque » selon les sentiments de chacun. Comment alors « freiner la diffusion du shopping religieux, y compris au sein de l’Église catholique » ?
Un autre domaine sur lequel Diotallevi constate que François est dramatiquement éloigné du grand projet ecclésial du Concile et de Paul VI, c’est le terrain politique. Ses discours aux « mouvements populaires » font l’éloge de fait de la terre, du toit et du travail comme principes « non négociables » sur fond d’une idée du « peuple » typiquement latino-américaine et péroniste, qui est radicalement incompatible avec le popularisme d’un don Luigi Sturzo ou d’un Giovanni Battista Montini.
En bref, entre une religion « à basse intensité » teintée de pentecôtisme d’un côté et de l’autre le projet complexe de renouvellement ecclésial du Concile et de Paul VI, le pape François donne le champ libre à la première option, ainsi qu’à un « embarrassant néo-cléricalisme » décliné cette fois à gauche, de nombre de ses courtisans.
« Du point de vue sociologique – conclut donc Diotallevi – le succès du pape François et l’insuccès de l’Église catholique ne sont nullement contradictoires parce qu’indépendamment des intentions des protagonistes, les raisons du succès de François ne s’opposent en rien avec le processus de décomposition progressif du catholicisme ».
Une tuile de plus, c’est qu’en ce début de XXIe siècle, les « sociétés ouvertes » sont de plus en plus en difficulté. Celles-ci se sont nourries d’un apport non-négligeable du christianisme mais le catholicisme romain ne peut pas non plus se passer d’elles « comme le prouve le retournement ecclésial de Vatican II, de la déclaration ‘Dignitis humanae’ sur la liberté religieuse jusqu’aux discours de Benoît XVI dans le Westminster Hall et devant le Bundestag ».
Mais pour le pape François, tout ça c’est du chinois.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.