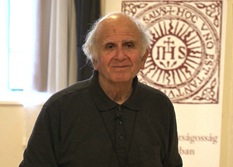Dans dix jour, le vendredi 28 avril, le pape François atterrira dans une Egypte encore marquée par les massacres du dimanche des rameaux perpétré par des musulmans dans deux églises chrétiennes bondées de fidèles.
Pourtant, le mantra des autorités vaticanes, à commencer par le pape, continue à être que “l’islam est une religion de paix”. Il est formellement interdit de parler de “guerre de religion” ou de “terrorisme islamique”.
“Civiltà Cattolica” avait bien tenté à une occasion d’affronter la réalité en face dans un éditorial de 2014 signé par le père Luciano Larivera qui écrivait ceci à propos de l’aile la plus belliqueuse du monde musulman:
“Il s’agit d’une guerre est une guerre de religion et d’anéantissement. Elle instrumentalise le pouvoir pour la religion et non l’inverse.”
Mais le père Antonio Spadaro était immédiatement intervenu pour démentir cette vérité simple inopinément parue dans la revue qu’il dirige.
A la veille d’un voyage de François au Caire, voici pourtant que cette vérité refait surface, bien argumentée, cette fois dans les pages de l’Osservatore Romano, et à nouveau sous la plume d’un jésuite.
Le nom de ce dernier est Henri Boulad. Il a 86 ans et est né à Alexandrie en Egypte. Il est issu d’une famille syrienne de rite melkite qui a fui les massacres antichrétiens de 1860. Il vit au Caire et ce qui va suivre est une partie de l’interview qu’il a accordée au quotidien du Saint-Siège en date du 13 avril, le jour du Jeudi Saint.
*
Q. — Père Boulad, vous avez été recteur du Collège des jésuites au Caire où de nombreux musulmans et chrétiens ont étudié dans un exemple concret de vivre-ensemble. Et pourtant aujourd’hui le monde semble subir les assauts de ce même islam.
R. — Mais de quel islam parlons-nous? Voilà toute la question. On trouve dans le Coran les versets de la Mecque et ceux de Médine. Dans ceux écrits à La Mecque, Mahomet tient un discours très ouvert qui parle d’amour et dans lesquels les juifs et les chrétiens sont nos amis, il n’y a pas d’obligation en matière de religion et Dieu est plus proche de nous. La première partie de la vie de Mahomet transmet donc un message spirituel, de réconciliation et d’ouverture.
Mais quand Mahomet quitte La Mecque pour fonder Médine, il y a un changement. De chef spirituel, il devient un chef d’Etat, militaire et politique. Aujourd’hui, ces versets de Médine forment les trois quarts du Coran et sont un appel à la guerre, à la violence et à la lutte contre les chrétiens.
Les musulmans des IXe et Xe siècles ont pris acte de cette contradiction et se sont mis ensemble pour tenter de la résoudre, le résultat fut qu’ils prirent cette décision désormais célèbre d’abrogeant et d’abrogé: les versets de Médine abrogent ceux de La Mecque. Mais ce n’est pas tout. Le soufisme fut mis à l’index et des bibliothèques entières furent incendiées en Egypte et en Afrique du Nord.
Il faudrait donc reprendre les versets originaux qui sont à la source, c’est-à-dire précisément les versets de La Mecque, mais ceux-ci sont abrogés, ce qui fait de l’islam une religion de l’épée.
Q. — De nombreux observateurs et analystes parlent pourtant d’un islam modéré.
R. — L’islam modéré est une hérésie mais nous devons faire la distinction entre l’idéologie et les personnes, la majeure partie des musulmans sont des gens très ouverts, gentils et modérés. Mais l’idéologie présentée dans les manuels scolaires est quant à elle radicale. Chaque vendredi, les enfants entendent la prédication de la mosquée qui est une incitation permanente: celui qui quitte la religion musulmane doit être puni de mort, il ne faut saluer ni une femme ni un infidèle. Heureusement cela n’est pas mis en pratique mais les frères musulmans et les salafistes souhaitent en revanche appliquer cette doctrine, les musulmans modérés n’ont pas voix au chapitre et le pouvoir se trouve dans les mains de ceux qui prétendent interpréter l’orthodoxie et la vérité.
Ceux qui ont le pouvoir aujourd’hui, ce ne sont pas les musulmans qui ont pris dans l’islam ce qui était compatible avec la modernité et avec la vie commune avec d’autres populations mais bien les musulmans radicaux, ceux qui appliquent une interprétation littérale et parfois instrumentale du Coran et qui refusent tout dialogue.
Q. — Mais en agissant de la sorte, ils nient l’œuvre de tous les grands penseurs musulmans comme Avicenne ou Al-Ghazali.
R. — Oui, et c’est là le point sensible. La réforme qui s’est produite dans l’histoire de l’islam a été réfutée. par exemple, le calife abbasside El Maamoun né à Bagdad en 786 et mort à Tarse en 833, disciple des mutazilites, les rationalistes de l’islam, a bien tenté une réforme mais qui se souvient de lui aujourd’hui? Ce qui a prévalu, c’est l’islam fermé et rigoriste de Mohammed ibn Abd al Wahhab. La dernière réforme en date fut celle tentée par le cheikh Mahmoud Taha au Soudan, qui a été cependant pendu sur la place de Karthoum parce qu’il affirmait que les versets de La Mecque devaient abroger ceux de Médine.
Il s’agit d’un problème interne à l’islam qui ne propose pas de réponses aux questions de la vie moderne et se trouve face au besoin de se réformer. L’islam aurait besoin d’un Vatican II.
Q. — Quels défis attendent aujourd’hui l’Egypte?
R. — Un phénomène dont on parle assez peu, c’est l’athéisme. En Egypte, il y a plus de deux millions d’athées. Ils le sont devenus parce qu’ils ne supportent plus que la religion incite à la violence ou aux exécutions capitales. Dans cela, il n’y a rien de divin. Ils ne veulent plus du fanatisme ou de la liturgie comme répétition mécanique de gestes et de prières. Et abandonner la religion est quelque chose d’inédit en Egypte et dans le monde arabe.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.