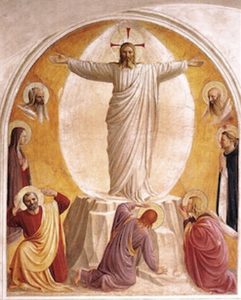 L’article de Settimo Cielo du 21 mars sur « l’histoire de Jésus réécrite par un grand historien » a suscité de vives critiques par email de la part d’un éminent théologien jésuite, élève de Joseph Ratzinger et appartenant à son « Schulerkreis ».
L’article de Settimo Cielo du 21 mars sur « l’histoire de Jésus réécrite par un grand historien » a suscité de vives critiques par email de la part d’un éminent théologien jésuite, élève de Joseph Ratzinger et appartenant à son « Schulerkreis ».
Ce qu’il conteste, c’est que l’on puisse attribuer à Jésus, pendant sa brève vie publique, une évolution dans le conscience de sa propre identité et de sa propre mission, faite d’expectatives déçues et transformées, de changements d’objectifs parfois soudains, d’annonces peu à peu modifiées, jusqu’à une plus complète auto-conscience de lui comme Messie sauveur qui n’aurait été atteinte qu’à l’imminence de sa mort sur la croix.
Ce parcours tortueux de Jésus est effectivement celui que l’historien de l’antiquité chrétienne Giorgio Jossa reconstruit dans son dernier essai annoncé par Settimo Cielo. Un Jésus « de l’histoire » – explique-t-il – qu’il n’oppose pas mais qu’il place à côté du Jésus des Évangiles, lesquels en racontent l’histoire à la lumière de sa résurrection.
Cependant, aux yeux de notre critique, cette reconstruction historique du parcours humain de Jésus semble trop en contradiction avec le Jésus de la foi pour être acceptable. Les disciples de Jésus, eux oui, pouvaient être incertains et tomber dans l’erreur face aux « signes » accomplis par lui. Mais pas lui. En lui il ne pouvait il y a voir d’ignorance ni d’incertitude concernant son identité et sa mission, au moins depuis qu’il avait atteint l’âge de raison : « Jésus savait certainement avec clarté qu’il était le Fils de Dieu et le Messie à l’âge de 12 ans ».
A 12 ans en effet, dans l’Évangile de Luc (2, 41-52), on peut lire que Jésus s’est disputé avec les docteurs de la loi dans le temple et qu’il les étonnait tous par « son intelligence et sa doctrine ». Et il a déclaré à Marie et à Joseph : « Ne savez-vous pas que je devais m’occuper des affaires de mon Père ? ».
Et justement, on trouve un passage dans un livre du grand théologien et ensuite cardinal Giacomo Biffi (1928-2015) intitulé « À la droite du Père » – la « synthèse de théologie dogmatique » la plus aboutie qu’il ait publiée et dont la dernière réimpression date de 2004 – dans lequel il fait ce commentaire, justement concernant Jésus parmi les docteurs du temple :
« Si à douze ans, il parle déjà de Dieu son Père d’une manière inédite jusqu’alors, révélant ainsi une certaine conscience de son inimitable condition filiale, il n’en demeure pas moins que le désir ardent d’entendre parler les sages et de les interroger nous dit qu’à cet âge, il est encore un chercheur de Dieu en herbe et que donc son propre mystère n’était pas encore pleinement révélé à ses yeux. »
Ce passage se trouve au sein du chapitre intitulé « L’aventure terrestre du Christ » justement consacré à « l’histoire » de Jésus de Nazareth et à sa « croissance » jusqu’au sommet de sa condition glorieuse.
Puisque Jésus était pleinement homme, écrit le cardinal Biffi, « nous devons retrouver un lui une croissance, non seulement dans sa vie corporelle mais également dans la réalité intérieure de son monde cognitif et volitif ». Une croissante, souligne-t-il, qui est bien présente dans la christologie du Nouveau Testament, par exemple dans « ce célèbre texte de la Lettre aux Hébreux (5, 8), où l’on dit que le Fils de Dieu ‘a appris par ses souffrances ce qu’était l’obéissance’ ».
« Jésus aussi – poursuit Biffi – a donc avancé progressivement dans la compréhension de l’oikonomia, c’est-à-dire du dessein de salut universel dont il était le centre. C’est pourquoi il a donc également été le premier théologien au sens dynamique du mot : le premier à enquêter sur le projet du Père. […] Et puisque la rédemption ne s’est pas accomplie en un instant mais a connu un déploiement qui a culminé dans sa mort et sa résurrection, sa connaissance ‘fonctionnelle’ ou prophétique a progressivement grandi en harmonie avec le déploiement du dessein salvifique. […] On constate non seulement dans la vie intérieure mais aussi dans l’action de Jésus de Nazareth une progression que la théologie traditionnelle de la rédemption laisse dans l’ombre ou à tout le moins n’appréhende pas de façon adéquate ».
Non pas en tant qu’historien mais bien en tant que théologien, le cardinal Biffi insiste pour mettre en évidence dans les textes mêmes du Nouveau Testament cette conception « dynamique » du parcours de Jésus, dynamique au point de faire prêcher à l’apôtre Pierre que ce n’est qu’avec le résurrection que « Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié » (Actes 2, 36).
« Selon la prédication primitive, donc – commente Biffi – Jésus n’entre en possession non seulement de son souveraineté sur le monde mais également de sa dignité messianique et de la pleine capacité d’obtenir le salut qu’au moment de son entrée dans le sanctuaire céleste ».
Mais que signifie – se demande Biffi vers la fin de ce chapitre dense – que ce n’est qu’alors que Jésus « est devenu » Fils de Dieu ?
« Il y a une réponse facile », dit-il, c’est celle selon laquelle « Jésus n’est ‘apparu’ comme Fils de Dieu qu’au moment de sa glorification, alors que pendant sa vie terrestre, sa dignité demeurait cachée ».
« Toutefois – poursuit-il – nous pensons que ces textes du Nouveau Testament peuvent être compris de manière plus approfondie si l’on réfléchit au fait que le Christ en relation de filiation avec le Père n’est que le Christ glorieux, dans lequel tous les moments précédents vivent et s’éternisent. […] Naturellement, cela ne signifie pas qu’au cours de sa vie terrestre Jésus n’était pas ‘Fils de Dieu’ mais qu’il y a une véritable progression dans toute la personnalité humaine, notamment dans sa relation ontologique avec le Père ; une progression, bien entendu, dans le chef de l’homo assumptus et non dans le chef du Père ».
« Le mystère du ‘développement’ de Jésus de Nazareth – conclut Biffi – c’est que sa vie terrestre a été, à tous les niveaux et dans toutes les fibres de son être, un chemin vers le Père ».
*
Biffi s’arrête là. Mais si nous retenons ce cadre théologique, il est évident que les recherches historiques sur le Jésus « de l’histoire » ne peuvent que faire l’objet d’une attention sérieuse. Et qu’elles doivent être appréciées comme telles, non pas à l’opposé mais à côté du Christ « de la foi ».
Post-scriptum
Les deux articles de Settimo Cielo sur le Jésus « de l’histoire » ont fait mouche, à voir la quantité et la qualité des commentaires qu’ils suscitent.
L’un de ces commentaires que nous retranscrivons ci-dessous nous a été envoyé par un théologien et professeur de christologie très apprécié, notamment par le cardinal Gerhard Müller, et qui est très critique de la position exprimée par le cardinal Giacomo Biffi qui, à son sens, tend à reconnaître en Jésus non seulement deux natures, une nature divine et une nature humaine, mais aussi deux personnes, « ce qui correspond à l’hérésie de Nestorius qui refait surface dans plusieurs courants de la théologie récente, surtout dans cette soi-disant ‘christologie d’en-bas’ qui s’appuie volontiers sur les résultats toujours changeants de la recherche sur le ‘Jésus historique’ ».
À lui la parole.
*
Cher M. Magister,
Je vous écrit au sujet de vos deux derniers articles concernant la question du Jésus historique. Je dois avouer que j’ai été surpris de voir que vous faisiez l’éloge du livre de Jossa, un expert que je respecte beaucoup même si je ne partage pas ses méthodes ni, par voie de conséquence, ses conclusions.
À la suite d’une réaction de la part d’un théologien, vous en êtes revenu à défendre les positions aujourd’hui plus courantes sur le « Jésus historique » en citant le regretté cardinal Biffi. Il ne fait aucun doute que c’était un homme de foi et de science. En général, ses écrits sont très fiables. Toutefois, il n’est pas dit que tout ce que le cardinal Biffi pensait était correct, ce qui vaut d’ailleurs pour n’importe quel auteur. Les phrases de Biffi que vous citez me semblent malheureusement, surtout quand il affirme : « … le désir ardent d’entendre parler les sages et de les interroger nous dit qu’à cet âge, il est encore un chercheur de Dieu en herbe… ». En réalité, le texte de l’Évangile dit que Jésus les écoutait et les interrogeait. On peut donc interpréter cela également dans le sens que Jésus les mettait à l’épreuve avec ses questions, comme nous pouvons lire que le Seigneur le fera souvent au cours de sa vie publique. D’autre part, immédiatement après, le texte continue en disant que tous restaient stupéfaits par son intelligence et ses réponses (là aussi, il nous semble voir le Jésus déjà adulte de nombreux épisodes de l’Évangile). Et s’il était vrai, comme le dit le cardinal Biffi, que l’épisode de Jésus à douze ans révèle qu’il était encore un « chercheur de Dieu en herbe », comme est-il possible qu’un dilettante de ce genre soit capable de dire à sa mère qu’il devait s’occuper des affaires de son Père ? Cette réponse montre une certitude inébranlable, fondée sur sa propre connaissance et certainement pas sur une recherche en herbe.
On peut affirmer qu’il y ait eu une certaine croissance dans l’intellect humain du Christ mais il s’agit de bien expliquer en quoi celle-ci pouvait bien consister. L’Évangile nous dit que Jésus grandissait non seulement en âge mais également en sagesse et en grâce. En interprétant le mot « sagesse » dans le sens d’une connaissance qui relève à la fois de l’intellect et de l’expérience, on peut parler d’une croissance « psychologique » (pour ainsi dire) du Christ. La croissance fait partie de la nature humaine et le Verbe a assumé une telle nature, donc cela ne pose aucun problème.
Mais en ce qui concerne la connaissance que le Christ avait de lui-même, c’est différent. Le Christ est une seule personne, même en deux natures. Il ne possède qu’un seul « je ». Il est vrai que le Christ possède deux intellects et deux volontés mais le sujet qui préside à ces deux volontés est unique, c’est le Logos. Par conséquent, le « je » du Christ est toujours celui du Verbe, aussi bien quand il pense et qu’il agit comme Dieu que quand il le fait en tant qu’homme. Comment peut-on émettre l’hypothèse que dans l’intellect humain, le Verbe grandirait dans une connaissance de soi qu’il ne posséderait pas auparavant ? La seule façon de le faire serait d’imaginer deux « je » dans le Christ, c’est-à-dire deux personnes, ce qui est l’hérésie de Nestorius.
Il n’est pas surprenant qu’une telle hérésie soit réapparue dans plusieurs courants de la théologie récente, surtout celle de la soi-disant « christologie d’en-bas » qui s’appuie volontiers sur les résultats toujours changeants de la recherche sur le « Jésus historique ». Remarquons que même le cardinal Biffi (qui n’était pas hérétique) parle d’une « véritable croissance de toute sa personnalité humaine » en Jésus. Mais en Jésus, la personnalité humaine n’existe pas, il n’existe que la nature humaine.
L’Église, depuis l’époque du Concile d’Éphèse, a choisi d’adopter la « christologie d’en-haut » qui par ailleurs est clairement fondée sur l’Écriture et qui a également été confirmée par saint Thomas comme étant la méthode propre et adéquate de la christologie ecclésiale.
Avec le cardinal Biffi, nous pouvons admettre qu’en Jésus, en tant qu’homme, il y a eu une croissance. Voici comment je l’explique : son intellect humain grandissait dans la capacité d’exprimer dans des concepts et des mots humains la révélation surnaturelle des mystères divins. C’est ainsi que Jésus a commencé à prêcher à trente ans parce que désormais son développement naturel était achevé et qu’en outre son humanité s’était manifestée (ou, selon les interprétations, fut pleinement consacrée) dans l’Esprit Saint au Jourdain. Mais tout cela n’implique pas le passage de la non-conscience d’être le Fils de Dieu à la conscience de l’être.
De quelle manière peut-ont se servir des recherches sur le soi-disant « Jésus de l’histoire » ? En ce qui me concerne, il me semble que Ricciotti et Ratzinger, entre autres, indiquent la voie à suivre. La recherche historique fournit une série d’éléments et d’observations qui peuvent s’avérer réellement précieux même en théologie. Donc, la théologie peut et doit intégrer ces éléments pour une meilleure compréhension. Le problème, c’est quand les historiens (comme Meier, Crossan, Sanders et bien d’autres) se mettent à jouer au « théologiens », tout en continuant à affirmer que leur recherche est simplement de nature historique. Mais cela n’est pas vrai, parce que le profil de Jésus qu’ils dépeignent (par ailleurs, il y a autant de « Jésus historiques » que d’auteurs qui le décrivent) détonne souvent et immanquablement avec le véritable Jésus, qui est celui des Evangiles (souvent qualifié, de manière péjorative de « Jésus de la foi »). Ratzinger part du principe méthodologiquement correct qu’il faut faire confiance aux Évangiles, même s’il faut rester responsable et informé des progrès de la science historique. Dans ses trois volumes, il n’a pu que tracer la voie. Il faut espérer que d’autres perfectionneront et mènent à son terme son intuition. Mais il n’est pas productif de séparer l’étude historique de l’étude théologique en les gardant en parallèle comme sur des rails, ou l’une à côté de l’autre. Seule l’intégration de la recherche historique dans la christologie ecclésiale est susceptible d’offrir, à mon humble avis, la solution.
Enfin, il faut se souvenir que le hiatus actuel entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi constitue un obstacle important pour la prédication et l’évangélisation.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.
