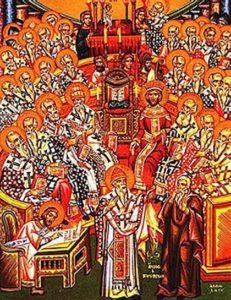 Le synode d’octobre dernier était censé porter sur les jeunes. Et pourtant, au moment de sa clôture, le Pape François a déclaré que « son premier fruit » avait été la « synodalité ».
Le synode d’octobre dernier était censé porter sur les jeunes. Et pourtant, au moment de sa clôture, le Pape François a déclaré que « son premier fruit » avait été la « synodalité ».
Et effectivement, les passages les plus surprenants du document final – qui sont également les plus contestés, avec des dizaines de voix contraires – sont justement ceux qui évoquent la « forme synodale de l’Église ».
C’est d’autant plus étonnant que le sujet de la synodalité n’avait pratiquement jamais été évoqué auparavant, ni au cours de la phase préparatoire du synode, ni pendant les débats, ni au sein des groupes de travail. Et pourtant, ce concept a fait son apparition dans le document final que le Pape lui-même a contribué à rédiger, selon « L’Osservatore Romano ».
Mgr Anthony Fisher, l’évêque de Sydney, a qualifié cela de « manipulation évidente », disant tout haut ce que plusieurs pères synodaux pensaient tout bas de cette manière contradictoire d’imposer une idée de gouvernement collégial par un ukase venu d’en haut.
Mais plus tard, c’est « La Civiltà Cattolica », le porte-parole officiel de la Maison Sainte-Marthe, qui est venu confirmer qu’il en était bien ainsi, en intitulant son éditorial sur le synode : « Les jeunes ont réveillé la synodalité de l’Église ».
Cela nous ramène inévitablement à ce synode de 1999 où le cardinal Carlo Maria Martini, jésuite lui aussi comme Jorge Mario Bergoglio, esquissait le « rêve » d’une Église en état synodal permanent, énumérant une série de « nœuds disciplinaires et doctrinaux » qu’il fallait traiter collégialement tout en concluant que pour de telles questions « même un synode ne suffirait pas » et qu’il faudrait sans doute « un instrument collégial plus universel et plus compétent », autrement dit un nouveau concile œcuménique, qui serait à même de « renouveler cette expérience de communion et de collégialité » qu’a été Vatican II.
Parmi les thèmes énumérés par le cardinal Martini, on retrouve justement ceux qui sont aujourd’hui au centre du pontificat de François :
- « la position des femmes dans l’Église »
- « la participation des laïcs à certaines responsabilités ministérielles »
- « la sexualité »
- « la discipline du mariage »
- « la pratique pénitentielle »
- « les rapports œcuméniques avec les autres Églises »
- « le rapport entre loi civile et loi morale »
Et à l’instar du cardinal Martini, François revient sans cesse sur le « style » avec lequel l’Église devrait aborder ces questions. Un « style synodal » permanent, c’est-à-dire une « façon d’être et de travailler ensemble, jeunes et vieux, dans l’écoute et le discernement, pour parvenir à des choix pastoraux qui correspondent à la réalité ».
Et ce, pour tout ce qui fait la vie quotidienne de l’Église, à tous les niveaux.
En outre, cette synodalité est également mise en avant comme une forme de gouvernement hiérarchique de l’Église universelle, dont les synodes sont l’expression à proprement parler – ce n’est pas pour rien qu’on les appelle « synodes des évêques » — tout comme les conciles œcuméniques.
Aujourd’hui, ils sont peu nombreux à promouvoir l’idée d’un nouveau concile œcuménique. Sous l’impulsion de François, les discussions portent davantage sur la façon de faire évoluer non seulement les synodes locaux et universels d’un rôle consultatif vers un rôle décisionnel mais aussi les conférences épiscopales, en décentralisant et en multipliant les niveaux de pouvoir et en les dotant également « d’une certaine autorité doctrinale authentique » (Evangelii gaudium, n.°32).
Mais il ne faut pas pour autant exclure que l’hypothèse d’un nouveau concile puisse elle aussi rapidement faire son chemin. Dans ce cas, pourquoi ne pas se mettre au travail et réétudier ce qu’ont été les conciles dans l’histoire de l’Église et ce qu’ils pourraient être à l’avenir ?
Le cardinal Walter Brandmüller, célèbre historien de l’Église et président du Comité pontifical des sciences historiques de 1998 à 2009, vient justement de tenir une conférence à Rome sur ce sujet le 12 octobre dernier. Nous la reproduisons dans son intégralité sur cette autre page de Settimo Cielo :
> Che cosa significa storia dei concili e a qual fine la si studia
Nous vous en proposons ci-dessous deux morceaux choisis.
Le premier concerne la supériorité du concile sur le pape affirmée par le décret de Constance « Haec sancta » de 1415, aujourd’hui revendiquée par un grand nombre de théologiens.
Le deuxième concerne l’éventualité d’un futur nouveau concile et sa mise en pratique, avec pratiquement deux fois plus d’évêques que Vatican II.
Bonne lecture !
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.
*
Constance ou la supériorité du concile sur le Pape
Depuis toujours, le décret de Constance « Haec sancta » de 1415 a fait l’objet de débats animés entre les partisans de la supériorité sur le pape et leurs détracteurs.
La polémique a récemment refait surface à l’occasion du jubilé du concile de Constance de 1964.
Le problème que l’on considérait alors comme particulièrement pressant portait sur la façon de concilier le décret de Constance « Haec sancta » — que non seulement Hans Küng, Paul de Vooght et d’autres, à l’époque suivis par Karl August Fink, considéraient comme la « magna carta » du conciliarisme, c’est-à-dire la précédence du concile sur le pape – avec le dogme de 1870 sur la primauté juridictionnelle et l’infaillibilité doctrinale du Pape.
Dans ce cas, un concile et un dogme n’en contredisent-t-ils pas un autre sur une question de foi importante ?
À l’époque, donc, plusieurs théologiens érudits, donc un éminent dogmaticien fribourgeois, s’étaient mis au travail pour lancer, à force de perspicacité, des tentatives de d’harmonisation d’une audace tenant parfois de l’acrobatie.
Et pourtant, un peu d’histoire aurait suffi à reconnaître l’inexistence du problème : le « concile » qui avait formulé le décret « Haec sancta » en avril 1415 – la pierre d’achoppement – n’avait rien d’un concile universel ; il s’agissait plutôt d’une assemblée de partisans de Jean XXIII. L’assemblée de Constance n’est devenu un concile universel que quand elle fut rejointe par les partisans des deux autres « papes schismatiques » en juillet 1415 et à l’automne 1417.
Les décisions prises en 1415 à Constance étaient privée de toute autorité aussi bien canonique que magistérielle. Et de fait, quand le Pape élu Martin V approuva les décrets décidées au cours des années 1415–1417, il prit soin d’exclure « Haec sancta ».
*
Comment convoquer un futur concile avec un nombre déterminé d’évêques
Au cours des dernières décennies, on a souvent parlé d’un concile « Vatican III ». Selon certains, il serait censé corriger les développements erronés de Vatican II alors que pour les autres, il devrait achever les réformes demandées à l’époque.
Un nouveau concile universel et œcuménique est-il donc souhaitable – et possible – à l’avenir ?
La réponse à cette question dépend essentiellement de la façon dont on pourrait imaginer un tel concile « géant », parce que c’est bien ce que ce serait.
Si l’on convoquait un concile aujourd’hui, les évêques qui y participeraient avec droit de vote seraient – selon les chiffres de 2016 – au nombre de 5237. Durant le concile Vatican II, il y avait 3044 évêques participants. Il suffit de lire ces chiffres pour comprendre que rien que pour cela, un concile normal serait déjà voué à l’échec. Et même en supposant qu’il soit possible de résoudre les immenses difficultés logistiques et économiques, d’autres considérations logiques élémentaires de nature sociologique et socio-psychologiques rendraient une telle aventure gigantesque irréalisable. Un tel nombre de participants au concile, qui pour la plupart ne se connaissent pas entre eux, constituerait une masse facilement manipulable entre les mains d’un groupe déterminé et conscient de son pouvoir. Les conséquences ne seraient que trop faciles à imaginer.
La question est donc de savoir comment, sous quelle forme et avec quelles structures, les successeurs des apôtres peuvent exercer de manière collégiale leur ministère d’enseignants et de pasteurs de l’Église universelle étant donné les circonstances que nous venons d’évoquer, d’une manière qui réponde aux exigences aussi bien théologiques que pastorales en la matière.
Si l’on cherche d’autres exemples dans l’histoire, notre regard est surtout attiré par le concile de Vienne de 1311–1312, auquel participèrent 20 cardinaux et 122 évêques. Sa particularité est la manière dont on est arrivé à un tel nombre. Nous en avons conservé deux listes de participants, une liste papale et une liste royale. Ceux qui n’étaient pas invités pouvaient s’y rendre mais n’étaient pas obligés de le faire. De cette façon, le concile pouvait rester à une échelle raisonnable, même si les critères de sélection des invités – en confrontant les deux listes – ne furent pas exempts de difficultés. Pour éviter les problèmes de ce genre, la liste des personnes à inviter devrait reposer sur des critères objectifs et institutionnels.
Aujourd’hui et à l’avenir, un processus synodal graduel pourrait lever ces objections. Prenons par exemple Martin V, qui au cours de la phase préparatoire du concile de Pavie-Sienne avait donné l’instruction – en fin de compte peu suivie – de faire précéder le concile universel par des synodes provinciaux. De façon analogue, même Vatican I avait été précédé par une série de synodes provinciaux, cf. la « Collection Lacensis » — qui avaient en quelque sorte préparé les décrets de 1870. C’est ainsi que l’on pourrait tenir à travers le monde, c’est-à-dire dans les différentes zones géographiques – on pourrait organiser des conciles particuliers pour discuter, au cours de la phase préparatoire du concile universel, les thèmes prévus pour ce dernier. Les résultats de ces conciles particuliers pourraient être présentés, débattus et abordés de manière définitive, par exemple déjà sous forme d’avant-projets de décrets, pendant le concile.
Les participants au concile seraient choisis par les conciles particuliers qui auraient eu lieu et seraient envoyés au concile universel avec le mandat de représenter leurs Églises particulières. C’est ainsi qu’un tel concile pourrait être qualifiés à bon escient d’« universalem Ecclesiam repraesentans » et agir comme tel.
Ce modèle permettrait non seulement de préparer un concile œcuménique bien à l’avance mais également qu’il se déroule sur une durée et avec un nombre de participants limités. Pourquoi alors ne pas également s’inspirer du premier concile universel, celui de Nicée en 325, qui est entré dans l’histoire comme le concile des 318 Pères (318 comme les « braves serviteurs » d’Abraham en Genèse 14, 14) ? Le « Credo » qu’ils formulèrent à l’époque est ce même « Credo » qui est aujourd’hui proclamé par des millions de catholiques dans le monde entier le dimanche et aux grandes fêtes. C’est ainsi que ce premier concile général d’à peine 3181 évêques est resté un point de cristallisation permettant de séparer la vérité de l’erreur.
*
Cette exigence de faire précéder les synodes et les conciles universels de moments synodaux dans les différentes Églises locales est également souligné dans le long document sur « La synodalité dans la vie et la mission de l’Église » publié le 2 mars 2018 par la Commission théologique internationale.