par Antonio Livi
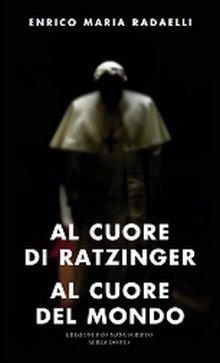 Je pense qu’il est indispensable, dans la conjoncture théologique et pastorale actuelle, de tenir compte de ce qu’Enrico Maria Radaelli vient de démontrer amplement dans son dernier ouvrage intitulé « Al cuore di Ratzinger. Al cuore del mondo » (Au cœur de Ratzinger. Au cœur du monde), Editions Pro-manuscripto Aurea Domus, Milano, 2017), c’est-à-dire que la présence hégémonique (d’abord de fait et ensuite de droit) de la théologie progressiste dans les structure du magistère et de gouvernement de l’Eglise catholique est notamment– et peut-être surtout – due aux enseignements du professeur Joseph Ratzinger, des enseignements qui n’ont jamais été reniés ni même dépassés par l’évêque, le cardinal ni le pape Joseph Ratzinger. Cette thèse, qui, formulée de la sorte, pourrait sembler inacceptable à beaucoup (je me réfère à tous ceux qui jusqu’à présent voyaient en Ratzinger cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi puis dans le Pape Benoît XVI un rempart providentiel contre ce qu’il qualifiait lui-même de « dictature du relativisme), trouve toute sa justification dans le livre de Radaelli qui analyse page par page le texte fondamental de Ratzinger, « Einführung in das Christentum : Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis » paru en 1968 compilant les leçons de théologie données au cours du semestre précédent par le jeune professeur de l’Université de Tübingen et dont le texte original a connu près de vingt-deux rééditions, dont la dernière date de 2017.
Je pense qu’il est indispensable, dans la conjoncture théologique et pastorale actuelle, de tenir compte de ce qu’Enrico Maria Radaelli vient de démontrer amplement dans son dernier ouvrage intitulé « Al cuore di Ratzinger. Al cuore del mondo » (Au cœur de Ratzinger. Au cœur du monde), Editions Pro-manuscripto Aurea Domus, Milano, 2017), c’est-à-dire que la présence hégémonique (d’abord de fait et ensuite de droit) de la théologie progressiste dans les structure du magistère et de gouvernement de l’Eglise catholique est notamment– et peut-être surtout – due aux enseignements du professeur Joseph Ratzinger, des enseignements qui n’ont jamais été reniés ni même dépassés par l’évêque, le cardinal ni le pape Joseph Ratzinger. Cette thèse, qui, formulée de la sorte, pourrait sembler inacceptable à beaucoup (je me réfère à tous ceux qui jusqu’à présent voyaient en Ratzinger cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi puis dans le Pape Benoît XVI un rempart providentiel contre ce qu’il qualifiait lui-même de « dictature du relativisme), trouve toute sa justification dans le livre de Radaelli qui analyse page par page le texte fondamental de Ratzinger, « Einführung in das Christentum : Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis » paru en 1968 compilant les leçons de théologie données au cours du semestre précédent par le jeune professeur de l’Université de Tübingen et dont le texte original a connu près de vingt-deux rééditions, dont la dernière date de 2017.
Enrico Maria Radaelli est connu pour être le meilleur disciple et interprète de Romano Amerio qui avait publié en 1985 « Iota Unum. Etude des variations de l’Eglise catholique au XXe siècle » que je considère comme étant la première dénonciation sérieuse, courageuse et documentée de la présence du modernisme théologique dans la forme (rhétorique) et dans la substance (idéologique) de « Gaudium et Spes » et d’autres textes conciliaires fondamentaux. Avec le même scrupule exégétique et la même honnêteté intellectuelle que son maître, Radaelli étudie attentivement le texte ratzingerien et en cite les passages fondamentaux tirés d’une édition récente en italien (cf. « Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo apostolico », Queriniana, Brescia 2000) en faisant immédiatement remarquer – et c’est l’une des données qui soutiennent la thèse de Radaelli – que Joseph Ratzinger, même quand il est devenu préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, n’a jamais éprouvé le besoin d’en revoir ni d’en modifier le contenu. En effet, il écrivait en 2000 que son livre aurait très bien pu être intitulé « Introduction au christianisme, hier, aujourd’hui et demain » en ajoutant :
« L’orientation de fond était correcte, à mon sens. D’où le courage que j’ai aujourd’hui de mettre encore une fois ce livre dans les mains des lecteurs » (“Saggio introduttivo alla nuova edizione 2000”, in “Introduzione al cristianesimo”, ed. cit., p. 24).
En somme, conclut Radaelli, la théologie que Ratzinger a toujours professé et que l’on retrouve dans tous ses écrits, même ceux qu’il a signés en tant que Benoît XVI (les trois livres sur « jésus de Nazareth » et les seize volumes d’ « Enseignements ») ne diffère pas substantiellement de celle de l’ « Einfürhung » et consiste en une théologique empreinte d’immanentisme dans laquelle tous les termes traditionnels du dogme catholique restent linguistiquement intacts mais dans laquelle leur sens est modifié : les schémas conceptuels propres à l’Ecriture, aux Pères et aux Magistère (qui présupposent ce que Bergson appelait « la métaphysique spontanée de l’intellect humain ») sont mis de côté parce qu’ils sont considérés comme incompréhensibles tandis que les dogmes de la foi sont réinterprétés avec les schémas conceptuels propres du subjectivisme moderne (du transcendantal de Kant à l’idéalisme dialectique de Hegel). Au détriment – observe avec justesse Radaelli – de la notion de base du christianisme, celle de la foi dans la révélation des mystères surnaturels de la part de Dieu, autrement dit de la « fides qua creditur ». Cette notion ressort irrémédiablement déformée dans la théologie de Ratzinger, du fait de l’adoption du schéma kantien de l’impossibilité d’une connaissance métaphysique de Dieu, avec pour conséquence le recours aux « postulats de la raison pratique », ce qui implique la négation des prémisses rationnelles de la foi et la substitution de la « raison pour croire » qui constituait l’argument classique de l’apologétique après Vatican I (Réginald Garrigou-Lagrange) par la seule « volonté de croire », théorisée par la philosophie de la religion de tendance pragmatiste (William James). Ratzinger a toujours soutenu, même dans ses discours les plus récents, que l’acte de foi du chrétien a pour objet spécifique non pas les mystères révélés par le Christ mais la personne même du Christ tel qu’il est connu dans l’Ecriture et dans la liturgie de l’Eglise. Mais il s’agit d’une connaissance incertaine et contradictoire, trop faible pour résister à la critique de la pensée contemporaine. De sorte que la théologie d’aujourd’hui, selon Ratzinger, ne parvient pas à parler de la foi sinon en des termes ambigus et contradictoires :
« Le problème de savoir exactement quel est le contenu et la signification de la foi chrétienne se trouve aujourd’hui entouré d’un halo d’incertitude comme jamais auparavant dans l’histoire » (« Introduzione al cristianesimo », Préface à la première édition, trad. it. Cit., p. 25).
En effet, la théologie d’aujourd’hui est contrainte d’admettre que, dans l’âme du croyant, l’acte de foi (délibéré même s’il est infondé) est toujours associé au doute. Et si c’est le cas, c’est parce que désormais, le fondement de l’acte de foi n’est plus, comme l’enseignait Vatican I, « l’autorité de Dieu qui ne peut ni se tromper ni tromper les hommes » mais bien l’homme lui-même, qui a voulu se construire une idée de Dieu susceptible de satisfaire ses propres besoins spirituels. Mais cette idée de Dieu, que l’homme religieux d’aujourd’hui a forgé à sa propre image et à sa propre ressemblance, est inévitablement incertaine et problématique et le théologien en dénonce l’incompatibilité radicale avec la culture contemporaine.
« Celui qui tente de répandre la foi au milieu des hommes qui vivent et pensent dans l’aujourd’hui peut vraiment avoir l’impression de passer pour un clown voire même un revenant sorti d’un sarcophage poussiéreux. […] Il constatera la condition d’insécurité dans laquelle s’enfonce sa propre foi, la puissance quasi irrésistible de l’incrédulité qui s’oppose à sa bonne volonté de croire. […] La menace de l’incertitude pèse sur le croyant. […] Le croyant ne peut vivre sa foi qu’en équilibre instable au-dessus de l’océan du néant, de la tentation et du doute, avec comme unique lieu possible pour sa foi la mer de l’incertitude » (« Introduzione al cristianesimo », Préface à la première édition, trad. it. cit., pp. 34–37).
Radaelli montre qu’on retrouve les mêmes expressions dans les déclarations du cardinal jésuite Carlo maria Martini, archevêque de Milan, qui répétait sans cesse : « Chacun de nous a en lui un croyant et un non-croyant qui s’interrogent mutuellement ». J’ajouterais personnellement que ce sont encore les mêmes expressions qu’employait Gianni Vattimo en théorisant le croire du chrétien comme appartenant à sa « pensée faible ». Mais c’est justement cette notion substantiellement sceptique de la foi en la Révélation qui, selon Ratzinger, permet à la théologie de se confronter utilement avec la philosophie et la science d’aujourd’hui, tout en concédant explicitement à ces dernières le présupposé épistémologique de l’impossibilité de la connaissance rationnelle de Dieu et de la loi morale naturelle. En effet, si même le croyant n’a pas la certitude de l’existence de Dieu et de sa présence visible en Christ, dans le dialogue de l’Eglise avec le monde moderne, il faut alors parler de Dieu comme si c’était une hypothèse : une hypothèse que Kant considérait nécessaire pour fonder la piété religieuse mais non comme une évidence de la raison naturelle sur la base de laquelle il est raisonnable de croire à la parole du Christ, révélateur du Père. Je comprends ainsi pourquoi Ratzinger, dans son engagement louable dans le dialogue pastoral avec la culture séculariste, demandait à ses interlocuteurs d’envisager une morale publique basée sur l’hypothèse de l’existence de Dieu (cf. Jürgen Habermas et Joseph Ratzinger, « Ragione e fede in dialogo », trad. it. par G. Bosetti, Marsilio, Venise, 2005). Voici les arguments avancés par le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi avant d’être élevé au pontificat :
« Nous devrions alors renverser l’axiome des philosophes des Lumières en disant : même ceux qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l’acceptation de Dieu devraient chercher à vivre et à diriger leur vie ‘veluti si Deus daretur’, comme si Dieu existait. C’était déjà le conseil que Pascal donnait à ses amis non-croyants et c’est le conseil que nous voudrions donner aujourd’hui encore à nos amis qui ne croient pas. De cette façon, personne ne se trouve limité dans sa liberté mais toutes nos actions trouvent le soutien et la signification dont elles ont un urgent besoin. » (« L’Europe dans la crise des cultures », conférence prononcée par le cardinal Ratzinger au Monastère Sainte Scholastique de Subiaco, le vendredi 1er avril 2005 à l’occasion du Prix Saint-Benoît « pour la promotion de la vie et de la famille en Europe »).
J’ai lu avec beaucoup d’attention les pages du livre de Radaelli dans lesquelles ce concept de « foi faible » est adéquatement documenté. Il aborde une problématique philosophico-théologique qui, par son importance du point de vue pastoral, est depuis toujours au centre de mes intérêts d’étude (Antonio Livi, “Razionalità della fede nella Rivelazione. Un’analisi filosofica alla luce della logica aletica”, Leonardo da Vinci, Rome 2005; “Logica della testimonianza. Quando credere è ragionevole”, Lateran University Press, Vité du Vatican 2007; “Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede”, Leonardo da Vinci, Rome 2010; “Quale pretesa di verità può essere riconosciuta alle dimostrazioni filosofiche dell’esistenza di Dio”, in “L’esistenza di Dio. Un’innegabile verità del senso comune che dalla formalizzazione metafisica può ricevere piena giustificazione dialettica”, F. Renzi dir., Leonardo da Vinci, Rome 2016, pp. 19–36).
Les analyses de Radaelli sur les textes de Ratzinger m’ont fait comprendre pourquoi ce grand théologien a accepté comme étant inévitable, à notre époque, l’interprétation fidéiste du christianisme et ait écarté, en la considérant comme une inutile « apologétique néoscolastique », le retour à la doctrine classique des « praembula fidei », que l’on doit bien entendu à Thomas d’Aquin mais qui a également été reçue dans les documents dogmatiques du Concile de Trente et du Concile Vatican I. La raison réside dans le fait que, depuis le début, c’est-à-dire depuis son « Einführung », Ratzinger a participé à cette opération culturelle redoutablement efficace que Cornelio Fabro qualifiait d’ « aventure de la théologie progressiste » dont Karl Rahner n’était pas l’unique protagoniste. On donne souvent trop d’importance aux différend doctrinal qui a opposé Ratzinger et Rahner et à la suite duquel le premier avait abandonné la rédaction de « Concilium » pour rejoindre les collaborateurs de « Communio ». La vérité, c’est que ce différend ne portait que sur la méthodologie dialectique et pas sur le fond du « tournant anthropologique » que tous deux entendaient imprimer à la théologie catholique en vue d’une réforme radicale de l’Eglise. Il suffit pour s’en convaincre de relire ce qu’écrivait Ratzinger sur les débuts de sa collaboration avec son collègue jésuite pendant les travaux du concile œcuménique :
« En travaillant ensemble , je me suis rendu compte que Rahner et moi, bien qu’étant d’accord sur de nombreux points et de nombreux aspirations, vivions du point de vue théologique sur deux planètes différentes. Tout comme moi, lui aussi s’engageait en faveur d’une réforme liturgique, d’une nouvelle place de l’exégèse dans l’Eglise et dans la théologie et sur bien d’autres choses mais ses motivations étaient très différentes des miennes. Sa théologie – en dépit des lectures patristiques de ses débuts – était entièrement caractérisée par la tradition de la scolastique suarézienne et de sa nouvelle version à la lumière de l’idéalisme allemand et d’Heidegger. C’était une théologie spéculative et philosophique dans laquelle, en fin de compte, l’Ecriture et les Pères ne jouaient plus un rôle très important et dans laquelle, par-dessus tout, la dimension historique n’avait que peu d’importance. En ce qui me concerne, ma formation avait au contraire été principalement marquée par l’Ecriture et par les Pères et se caractérisait par une pensée essentiellement historique (Joseph Ratzinger, « La mia vita. Autobiografia », Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 2005, p. 123).
Cette digression me permet de réaffirmer que la thématique abordée dans l’essai de Radaelli ainsi que le sens critique pointu avec lequel il la traite rendent un grand service à la compréhension de ce qui est en train de se passer dans l’Eglise, des années soixante jusqu’à nos jours. Il s’agit d’événements que j’ai souvent résumés par l’expression « l’hérésie au pouvoir ». Je m’exprime en des termes qui peuvent sembler simplistes ou exagérés mais que les faits justifient pourtant amplement. La réalité c’est que la théologie néomoderniste, avec sa dérive hérétique évidente, a joué un rôle de plus en plus hégémonique au sein de l’Eglise (dans les séminaires, les athénées pontificaux, les commissions doctrinales des conférences épiscopales et dans les dicastères du Saint-Siège) et que, depuis ces postes de pouvoir, elle a influencé les thématiques et le langage des différentes expressions du magistère ecclésiastique et que l’on retrouve cette influence (à des degrés divers bien entendu) dans tous les documents du concile Vatican II et dans de nombreux enseignements des papes de la période postconciliaire (cf. Antonio Livi, “Come la teologia neomodernista è passata dal rifiuto del Magistero ancora dogmatico all’esaltazione di un Magistero volutamente ambiguo”, in “Teologia e Magistero, oggi”, Leonardo da Vinci, Rome 2017, pp. 59–86). Les papes de cette période ont tous été conditionnés, d’une façon ou de l’autres, précisément par cette hégémonie que Joseph Ratzinger, peu avant son élection comme Pape, qualifiait de « dictature du relativisme ». Il ne fait aucun doute que Paul VI ait présidé et dirigé avec sagesse le Concile après la mort de Jean XXIII et on se rappellera quelques-unes de ses interventions providentielles dont la rédaction de la « Nota explicativa previa » annexée à la constitution dogmatique « Lumen gentium » ainsi que de l’exclusion du thème du célibat des prêtres et de la contraception des débats en séance (thèmes qu’il abordés par la suite dans les encycliques « Sacerdotalis coelibatus » et « Humanae vitae »), mais dans le même temps, il a soutenu l’interprétation du Concile comme « tournant anthropologique » de l’ecclésiologie, comme l’’instance suprême d’une reconnaissance des valeurs humanistes de la modernité, sur la base d’une « religion de l’homme » commune. Jean-Paul II eut bien sûr le courage d’en condamner les déviations théologiques au niveau moral (cf. l’encyclique « Veritatis splendor ») et de reprendre l’enseignement de Vatican I contre le fidéisme (cf. l’encyclique « Fides et ratio ») tout en permettant à Karl Rahner de consolider son hégémonie sur les études ecclésiastiques et de l’honorer publiquement aussi bien lui (dans une lettre d’éloges pour ses 80 ans) que d’autres personnalités importantes de la théologie progressiste (en créant cardinaux Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar). Dans le même temps, il est resté sourd aux appels de nombreuses personnalités de l’épiscopat mondial lui demandant de combattre efficacement la dérive hérétique du mouvement œcuménique et de ses rapports avec les juifs (cf. Mario Oliveri « Un Vescovo scrive alla Santa Sede sui pericoli pastorali del relativismo dogmatico », Leonardo da Vinci, Roma 2017). Sans parler du pape actuel. D’ailleurs les quelques citations très significatives de lui mentionnées par Radaelli dans son dernier et très précieux ouvrage suffisent.
Mgr Antonio Livi est doyen émérite de la Faculté de philosophie de l’Université pontificale du Latran, académicien pontifical et Président de l’International Science and Commonsense Association.
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.