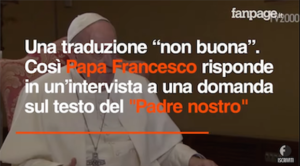 « Roma locuta, causa finita ». Comme il était facile de le pronostiquer, les évêques italiens ont exaucé le désir exprimé par le Pape François de remplacer à la messe la demande du Notre Père « et ne nous induit pas à la tentation » par « et ne nous abandonne pas à la tentation ».
« Roma locuta, causa finita ». Comme il était facile de le pronostiquer, les évêques italiens ont exaucé le désir exprimé par le Pape François de remplacer à la messe la demande du Notre Père « et ne nous induit pas à la tentation » par « et ne nous abandonne pas à la tentation ».
Il était impossible de défendre la « vieille » version, étant donné que la question n’a même pas fait l’objet d’un vote. Parce que, aux dires de François, il n’y a que le diable qui tente et il n’est pas admissible que Dieu lui-même nous « induise », c’est-à-dire littéralement nous « conduise dans » — comme dans le latin « inducas » et dans l’original grec de l’Évangile « eisenènkes » — la tentation.
La version anglaise du « Notre Père » qui est en usage aux États-Unis est restée fidèle au texte évangélique original : « And lead us not into temptation ». Tandis que les traductions utilisées en France et dans les autres pays francophones sont conformes aux souahits du Pape François : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation », tout comme celle qui est à présent utilisée dans les différents pays hispanophones, Argentine comprise : « Y no nos dejes caer en la tentación ».
Mais en toute logique, si Dieu ne peut pas nous « induire » en tentation, on ne comprend pas bien pourquoi il lui serait permis de nous « abandonner » à celle-ci. Pendant deux millénaires, l’Église n’avait jamais osé imaginer changer cette parole difficile de l’Évangile mais tâchait plutôt de l’interpréter et d’expliquer sa signification authentique.
C’est de ce constat que part la réflexion qui va suivre. L’auteur, Silvio Brachetta, est diplomate à l’Institut des Sciences Religieuses de Trieste et se consacre particulièrement à l’étude de la théologie de saint Bonaventure de Bagnoregio. Son article a été publié dans l’hebdomadaire diocésain « Vita Nuova ».
*
Brève réflexion sur le « nouveau » Notre Père
de Silvio Brachetta
On ne comprend pas bien en quoi un Dieu qui nous « induit », qui nous conduit dans la tentation serait pire qu’un Dieu qui nous « abandonne » à celle-ci. C’est un mystère de l’exégèse moderne mais également de la présomption humaine, en tout cas si l’on s’en tient à ce que disait saint Antoine, le Père du désert :
« Un jour, un groupe d’anciens rendit visite au Père Antoine et le Père Joseph les accompagnait. Et voici que le Père, pour les mettre à l’épreuve, leur proposa une parole de l’Écriture et leur en demanda le sens, en commençant par interroger les plus jeunes. Chacun s’exprima selon ses capacités. Mais à chacun d’eux, le vieillard répondit : ‘Tu n’as pas encore trouvé’. Enfin, il demanda au Père Joseph : ‘Et toi, que dis-tu de cette parole ?’ Celui-ci répondit : ‘Je ne sais pas’. Le père Antoine répondit alors : c’est le Père Joseph qui a trouvé la voie, parce qu’il a dit ‘Je ne sais pas’ ». (Apophtegmata Patrum, 80d ; PJ XV, 4).
Il y a, dans les Saintes Écritures, des choses faciles à comprendre, des choses difficiles et des choses que l’on ne peut pas comprendre : est-ce que quelqu’un s’en souvient ? Non, on a tout oublié. C’est le sens littéral qui dirige et qui oriente tous les autres sens des Écriture : est-ce que quelqu’un s’en souvient ? Non, on a tout oublié. L’exégèse des textes ne peut trahir l’exégèse des pères et des docteurs de l’Église : quelqu’un s’en rappelle-t-il ? Non, on a tout oublié.
Quant aux œuvres de Dieu, il devrait être clair que le Dieu du « Notre Père » qui induit à la tentation est le même Dieu qui fait dire à Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 34). Il ne fait aucun doute – et le magistère de l’Église n’en a jamais douté – que l’ « eisenènkes » grec du « Notre Père » indique un complément circonstanciel de lieu et que le « sabactani » araméen de Mc 15, 34 signifie « abandon ».
Il est cependant vrai que l’interprétation que saint Thomas ou saint Augustin font de ces passages laisse le lecteur sur sa faim, étant donné que les docteurs savent bien que si « fides et ratio » vont de pair, ils ne coïncident nullement. Saint Thomas et saint Augustin scrutent le mystère mais ils le font dans l’humilité : et ils parviennent parfois à satisfaire pleinement une interrogation mais il se peut parfois qu’ils ne répondent pas ou qu’ils ne satisfassent qu’en partie ceux qui cherchent une explication.
L’opération théologique actuelle est souvent indécente parce qu’elle vise à forcer ces portes inviolables du mystères qu’Hildegarde de Bingen déconseillait fermement de violer (cf. « Le livre des œuvres divines »). D’où vient tout cet orgueil ? Comment se fait-il que le théologien moderne soit devenu incapable de dire « je ne sais pas » devant des questions sur lesquelles Dieu a décrété que demeure le mystère ? Même les païens étaient souvent plus humbles que nombre de nos contemporains. « Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera. Nul mortel n’a pu lever jusqu’ici le voile qui me couvre », disait la Pythie de Plutarque (« De Fato »).
L’art de forcer ou de falsifier un texte quand on n’en comprend plus le sens ou qu’il ne correspond plus aux attentes de nos caprices est vieux comme le monde. Mais l’art de l’humilité, l’art du scribe fidèle qui transmet la voix de Dieu en recopiant les Écritures et en cherchant à retranscrire fidèlement, syllabe après syllabe, ce qui a été reçu des pères, lui aussi est vieux comme le monde.
La vérité a été confessée par les saints à plusieurs reprises : le Dieu qui nous « conduit dans » la tentation est bon, tout comme le Dieu qui nous « abandonne » à celle-ci. Et il est bon parce qu’il écoute la prière du pénitent, qui demande avec insistance : « Ne nous induit pas, ne nous abandonne pas ». Dieu, donc, n’induit pas et n’abandonne pas ses enfants qui se convertissent et qui le prient mais il abandonne l’impie qui le blasphème.
Le mystère demeure et la réalité de la « perdition » — l’« abaddôn » hébreu de l’Apocalypse (9, 11) – ne peut pas être rayé par la plume d’un faussaire. Cet « ange de l’abysse » existe donc bel et bien puisque Dieu permet qu’il existe, tout comme l’enfer existe ainsi que la possibilité de se damner. Derrière la négation du « ne nos inducas » de l’Évangile se cache le refus présomptueux d’un scandale : le scandale de la perdition éternelle de l’impie et le fait que le Christ puisse précisément être « pierre d’achoppement » et lui-même « scandale ».
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.